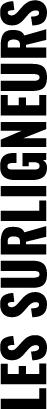Suite au meurtre de Dean Verbeckmoes, un enfant âgé de seulement quatre ans, et au constat que le principal suspect, Dave De Kock, avait déjà été condamné et avait purgé sa peine pour meurtre d’un enfant de deux ans, Vincent Van Quickenborne, ministre de la Justice, annonce sa volonté de prolonger la durée de la peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, actuellement limitée à quinze ans, voire de l’imposer à vie dans certains cas. Cette proposition semble discutable au vu du principe de proportionnalité des peines et de l’objectif de réinsertion assigné à la peine privative de liberté.
La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines, une peine complémentaire depuis 2012
La mise à la disposition du tribunal de l’application des peines (TAP) est une peine complémentaire, tantôt facultative, tantôt obligatoire, qui est prononcée par le juge du fond dans les cas prévus par la loi (entre autres pour sanctionner certains types de récidive, certaines infractions graves, les auteurs d’infractions sexuelles, …). Concrètement, lorsqu’une personne condamnée aura terminé de purger la peine principale, le tribunal de l’application des peines décide, après analyse du risque de récidive, s’il convient de la priver de liberté ou de la libérer sous surveillance. Si la libération sous surveillance est octroyée, la personne condamnée devra respecter une série de conditions. Le contrôle du respect de ces conditions est assuré à la fois par les assistants de justice et le ministère public. À la fin de la période de mise à la disposition du TAP, la personne est définitivement libérée ; néanmoins, deux ans après l’octroi d’une libération sous surveillance, et puis tous les deux ans, elle peut solliciter la levée de la mise à la disposition du TAP.
Cette peine complémentaire n’a été introduite dans le Code pénal qu’en 2012. Il existait déjà « la mise à la disposition du gouvernement » mais le régime d’application était différent. Or, Dave De Kock, responsable de la mort du jeune Dean, a été condamné avant 2012 pour le meurtre de Miguel, un enfant alors âgé de deux ans. Dave De Kock a donc purgé sa peine principale – 10 ans d’emprisonnement – sans peine complémentaire puisqu’elle n’était pas encore prévue à l’époque. Dave De Kock ne s’est jamais vu octroyer de libération conditionnelle, faute de pouvoir trouver une place dans un centre psychiatrique comme l’exigeait le tribunal de l’application des peines.
Vu le drame récent et la récidive de David De Kock, le ministre de la Justice a annoncé sa volonté de prévoir, dans le cadre de la réforme du Code pénal, l’extension de la durée maximum de la peine complémentaire de mise à la disposition du TAP, aujourd’hui fixée à 15 ans maximum, vers une durée potentiellement à vie dans certains cas. Cette proposition est toutefois problématique pour plusieurs raisons.
L’allongement de la peine complémentaire pourrait heurter le principe de proportionnalité des peines
Consacré à l’article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation, le principe de proportionnalité en droit pénal impose que chaque peine prononcée par les juges soit proportionnée par rapport à la gravité des faits commis et par rapport à la personnalité et au parcours de vie du justiciable. Comme le souligne le professeur Franklin Kuty, il doit aussi exister un rapport de proportionnalité entre la peine et les buts qu’elle poursuit : la peine doit tendre non seulement à exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise, mais à permettre, à terme, la réinsertion du condamné.
La loi sur la mise à disposition du tribunal de l’application des peines impose que la durée de cette peine complémentaire ne puisse être inférieure à 5 ans ou supérieure à 15 ans. La peine complémentaire de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines aboutit à un allongement réel de la peine subie par le condamné. On peut d’ailleurs interroger le caractère « complémentaire » d’une peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines lorsque celle-ci excède largement la durée de la peine principale. Si on écope d’une peine de 5 ans de prison, mais avec une peine complémentaire de 15 ans, cette peine de 15 ans est-elle encore réellement “complémentaire”? N’est-elle pas excessive ?
Cette proposition du Ministre étonne d’autant plus que la commission de réforme du droit pénal a fait le choix de supprimer la peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines dans son avant-projet de Code pénal. Pour la commission de réforme, cette peine complémentaire est inconciliable avec le principe de proportionnalité des peines.
Une peine à vie sans possibilité de réinsertion pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant
La Cour européenne des droits de l’homme a déjà condamné des États pour avoir imposé une peine inhumaine ou dégradante, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, lorsque cette peine excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. La peine doit être proportionnée à la gravité de l’infraction, et l’exécution de la peine doit être proportionnée aux objectifs poursuivis par celle-ci. Les lois pénitentiaires assignent comme objectif principal à l’exécution de la peine privative de liberté la préparation de la réinsertion sociale des condamnés. Un condamné qui serait maintenu en prison, sans espoir raisonnable de libération en raison de l’absence ou de la grande insuffisance de moyens déployés pour l’aider à préparer à sa réinsertion en détention, pourrait se trouver dans une situation constituant un traitement inhumain ou dégradant, en violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conclusion, un allongement de la peine de mise à la disposition du tribunal de l’application des peines semble entrer en contradiction avec le principe de proportionnalité des peines et pourrait, en l’absence de moyens réels déployés en prison pour favoriser la réinsertion, constituer un traitement inhumain ou dégradant.
Contacté par nos soins, Vincent Van Quickenborne a indiqué qu’il tiendra compte de ces arguments « dans les analyses ultérieures que nous ferons dans le cadre de la réforme du Code pénal et du dispositif relatif à la mise à disposition du tribunal de l’application des peines ».
Mis à jour le 23 février 2022
Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu