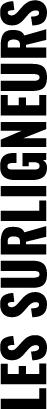Le débat sur l’abattage rituel est compliqué. Qui dit abattage rituel, dit rite et donc religion. Les religions sont protégées par des normes de très haute valeur juridique. Si on interdit l’abattage rituel, on s’attaque à deux religions qui pratiquent l’abattage rituel sans étourdissement, on ne peut donc pas le faire n’importe comment. Une proposition d’ordonnance à Bruxelles pour interdire tout abattage sans étourdissement préalable, y compris l’abattage rituel, fait actuellement l’objet de vifs débats au sein des formations politiques bruxelloises.
LES TECHNIQUES D’ABATTAGE (RITUEL)
Les méthodes d’abattage standard prévoient que l’animal soit étourdi préalablement à son abattage. L’étourdissement permet de rendre l’animal inconscient, dans le but de limiter la douleur ressentie au moment de l’abattage. Le terme « étourdissement » renvoie à une série de techniques qui provoque une perte de conscience immédiate dans le but de rendre l’animal insensible à la douleur au moment de la saignée et jusqu’au moment de sa mort. Des exemples de techniques d’étourdissement sont le gazage ou le choc électrique.
Les techniques d’abattage rituel exigent que l’animal soit encore conscient au moment de sa mise à mort, afin de garantir que sa viande puisse être consommée dans le respect du culte religieux. En effet, qui dit abattage rituel, dit rite et donc religion. Les religions sont protégées par des normes de très haute valeur juridique. La liberté de religion (et son expression via des rites) figure parmi nos droits fondamentaux, ceux qui sont défendus par notre Constitution, et par des traités internationaux comme la Convention européenne des droits de l’homme et la Charte des droits fondamentaux. Il est important de bien comprendre les techniques précises d’abattage, qui varient en fonction des animaux, pour savoir si elles sont nécessairement plus respectueuses du bien-être animal ou non. Sinon, l’atteinte à la liberté de religion n’est pas proportionnée.
L’ABATTAGE RITUEL FACE AU BIEN-ÊTRE ANIMAL
En Belgique, depuis la 6e réforme de l’Etat en 2014, le bien-être animal est une compétence régionale. Depuis lors, la Flandre et la Wallonie ont toutes les deux adopté des dispositions imposant l’étourdissement préalable à l’abattage des animaux pour le bien-être de l’animal. Ces mesures ont fait l’objet de recours devant la Cour constitutionnelle. Ceux-ci ont été rejetés, la Cour constitutionnelle a validé la mesure pour des raisons sanitaires. Cette règle ne prévoit pas d’exception pour les rites liés aux religions juives et musulmanes. En revanche, à Bruxelles, l’abattage rituel sans étourdissement est toujours autorisé. Récemment, le parti socialiste s’est penché sur une proposition d’ordonnance prévoyant d’interdire cette forme d’abattage sans étourdissement préalable. Le Parti socialiste a d’abord soutenu cette proposition d’ordonnance, mais a finalement décidé de voter contre. Selon le PS, la proposition se concentre trop sur les dernières secondes de la vie de l’animal, et il aurait été plus intéressant d’avoir un véritable débat sur le Code du bien-être animal dans son ensemble.
Ce débat clive le paysage politique bruxellois, avec d’un côté des partis tels que DéFi et le MR, qui soutiennent l’interdiction, et de l’autre, le groupe socialiste entre autres, qui veut continuer à permettre l’abattage rituel sans étourdissement préalable.
LA RÉGLEMENTATION EN BELGIQUE VARIE ENTRE LES TROIS RÉGIONS
Avant la 6e réforme de l’Etat, cette matière était réglée par la loi du 14 août 1986. Dans un but de protection du bien-être animal, la législation prévoyait que “l’abattage ne peut se pratiquer qu’après étourdissement de l’animal” et qu’“il faut privilégier la méthode la moins douloureuse”. Cependant, une exception était prévue puisque la législation précisait que ces dispositions “ne s’appliquent toutefois pas aux abattages prescrits par un rite religieux”.
En 2006, une proposition de loi tendant à interdire l’abattage rituel avait déjà vu le jour. Mais cette proposition avait été considérée, dans un avis du Conseil d’État, comme portant atteinte de manière disproportionnée à la liberté de religion garantie par l’article 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH). D’un côté, il y a un droit fondamental à sa religion et de l’ autre, il y a le bien-être animal, qui n’est pas encore réellement un droit à part entière, même si l’évolution de la société va dans ce sens. Les atteintes permises à la liberté de religion sont listées dans l’article 9 §2 de la CEDH et… le bien-être animal n’y figure pas!
Mais, malgré cet avis du Conseil d’État – qui proposait de trouver un équilibre entre liberté de religion et bien-être animal, plutôt qu’une interdiction pure et simple – la Région flamande et la Région wallonne ont toutes les deux adopté des réglementations interdisant d’abattre des animaux sans étourdissement préalable dans le cadre de rite religieux.
LE DROIT EUROPÉEN LAISSE AUX ÉTATS LA MARGE DE DÉCIDER D’INTERDIRE OU NON
En 1993, une directive européenne permet de déroger à l’exigence d’étourdissement en cas d’abattage rituel. Mais, depuis un règlement européen de 2009, qui autorise toujours l’abattage rituel sans étourdissement préalable, l’ouverture d’abattoirs temporaires est interdite. Ces abattoirs temporaires permettaient à la communauté musulmane de pratiquer l’abattage rituel des moutons dans des conditions d’hygiène et de propreté irréprochables dans le cadre de leurs célébrations religieuses.
De plus, face à l’interdiction absolue en Flandre d’abattage sans étourdissement préalable, le tribunal belge s’est tourné vers la Cour de justice de l’Union européenne par voie de question préjudicielle. La Cour a donné raison à la Région flamande d’interdire de manière absolue l’abattage sans étourdissement préalable. Pour la première fois, la Cour de justice de l’Union européenne était confrontée à la difficile question de la conciliation de la protection du bien-être animal et de la liberté de religion. La Cour laisse donc une marge d’appréciation aux Etats-membres. Le raisonnement de la Cour a d’ailleurs été repris mot-à-mot par la Cour constitutionnelle belge dans son dernier arrêt en date. La Cour belge rejette les recours contre l’interdiction flamande et wallonne de l’abattage sans étourdissement pour les raisons suivantes : “La liberté de pensée, de conscience et de religion doit être interprétée à la lumière des conditions de vie actuelles et des conceptions prévalant de nos jours dans les Etats démocratiques”.
Mais le 5 avril 2022, neufs citoyens belges de confession juive, dont le grand rabbin de Bruxelles, Albert Guigui, ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’interdiction de l’abattage rituel en Belgique. Affaire à suivre donc…
Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu