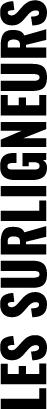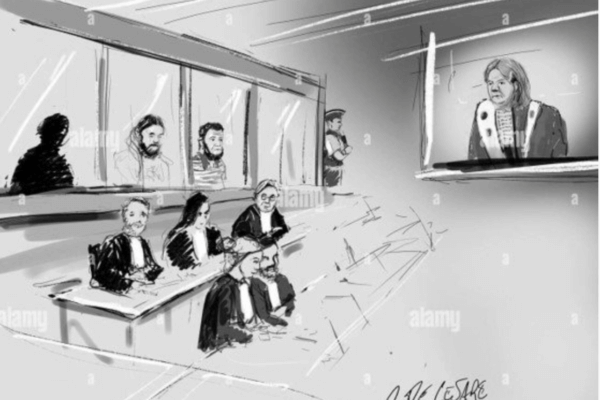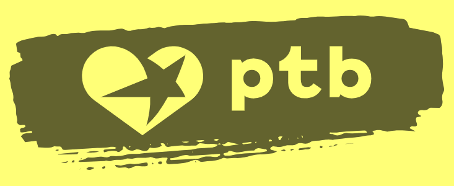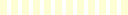Qu’est-ce qu’initialement le décret Paysage ?
Depuis la rentrée académique 2014-2015, l’enseignement supérieur en Belgique francophone a été modifié à la suite de l’introduction du décret Paysage, également connu sous le nom de décret Marcourt, en référence à la personne qui l’a porté en 2013, Jean-Claude Marcourt, ancien ministre socialiste au sein du gouvernement de la Communauté française de Belgique.
L’objectif initial de ce décret était de moderniser le système éducatif en alignant ses normes sur le modèle européen. Conformément à ce décret, chaque cours dispensé dans l’enseignement supérieur se voyait attribuer un nombre spécifique de crédits, chaque année académique étant évaluée sur la base de 60 crédits. Bien que l’année académique soit théoriquement complétée par l’obtention de ces 60 crédits, la réussite pouvait néanmoins être acquise avec un minimum de 45 crédits, représentant les trois quarts du programme. Les crédits manquants étaient alors reportés à l’année suivante.
Pourquoi ce décret a-t-il été réformé en 2021 ?
La ministre de l’Enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, a annoncé lors de la rentrée 2020 son intention de réformer le décret Paysage pour l’année académique 2022-2023, en raison de ses effets potentiellement indésirables. Parmi ceux-ci, un allongement significatif de la durée des études. En effet, certains étudiants se retrouvaient dans des situations où ils traînaient d’année en année des examens qu’ils n’arrivaient pas à réussir et finissaient par se retrouver en situation d’échec à un stade avancé de leurs études.
C’est pourquoi, en septembre 2021, cette réforme a été votée par le MR, le PS et Ecolo. Depuis la rentrée académique 2022-2023, de nouvelles règles ont été mises en place pour remédier aux « effets indésirables » du décret Paysage, lesquelles posent d’importants problèmes en termes de finançabilité pour les étudiants. En effet, les études supérieures sont financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, permettant à l’établissement de recevoir des subsides pour couvrir les coûts de l’année académique. Cependant, si l’étudiant ne répond plus aux critères de réussite requis, l’établissement ne recevra plus ces subsides et pourra décider de ne pas le réinscrire l’année suivante. Cette réforme a imposé une limite maximale de 5 ans aux étudiants quant à l’obtention de leurs crédits de bachelier, limite qu’ils doivent impérativement respecter sous peine de perdre leur finançabilité.
Plus précisément, avec ce nouveau système, les étudiants ont donc 5 ans (ou 6 ans pour les étudiants qui sont réorientés), pour valider l’intégralité de leur bachelier, soit 180 crédits. De plus, ils ne disposent plus que de 2 ans pour valider l’intégralité de leur première année de bachelier et de 4 ans pour valider, au minimum, 120 crédits.
Pourquoi les modifications du décret ont-elles suscité la controverse ?
Les nouvelles règles de financement ont engendré une incertitude pour un grand nombre d’étudiants. La FEF prévoyait que pas moins de 75 000 étudiants risquaient d’être complètement exclus des études supérieures.
C’est pourquoi les étudiants se sont mobilisés, via la FEF, en lançant une pétition signée par plus de 50 000 étudiants, tout en organisant 4 manifestations. Pas moins de 6000 mails ont été envoyés, par les étudiants, aux députés pour dénoncer la réforme du décret.
Que s’est-il passé concrètement la nuit du 16 au 17 avril 2024 ?
Face à cette forte mobilisation de la part des étudiants, poussés par la FEF, le PTB, PS et ECOLO, se sont positionnés contre la réforme du décret qu’ils avaient pourtant votée 3 ans plus tôt. Ils ont déclaré vouloir protéger les étudiants, avec un nouveau texte, voté à une majorité alternative (8 voix favorables provenant du PS, Ecolo et PTB contre 5 contre de la part du MR et des Engagés). A la suite du vote, le MR et les Engagés ont exprimé leur mécontentement, évoquant une trahison de la part du PS et d’Ecolo.Pierre-Yves Jeholet, ancien ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a dénoncé un acte mensonger et déloyal et a annoncé qu’il demanderait un renvoi au Conseil d’État afin que cette réforme ne voie jamais le jour.
Dernier doute concernant l’entrée en vigueur désormais complètement dissipé.
Après l’adoption de la réforme du décret, le MR et les Engagés ont tenté d’empêcher sa mise en vigueur en saisissant le Conseil d’État. Cependant, le Conseil d’État a déclaré la demande irrecevable, jugeant que le texte, déjà adopté, ne relevait plus de son contrôle préventif habituel. Il a donc refusé de se prononcer sur la légalité ou le contenu du décret.
Le Conseil d’État a estimé le jeudi 30 mai 2024 la demande d’avis sur la proposition de décret PS-Ecolo irrecevable pour plusieurs raisons procédurales spécifiques :
- Nature de la Demande : Le Conseil d’État exerce un contrôle préventif des textes législatifs, ce qui signifie qu’il ne peut se prononcer que sur des textes avant leur adoption définitive. Dans ce cas, la proposition de décret avait déjà été adoptée en commission et en plénière par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le texte était donc devenu définitif et ne pouvait plus être soumis à l’examen préventif du Conseil d’État.
- Texte Modifié : La proposition de décret avait été considérablement modifiée depuis sa version initiale. Le Conseil d’État a jugé qu’il ne pouvait se prononcer sur un texte qui avait évolué au point de ne plus correspondre à celui qui avait été initialement soumis pour avis. Cela compliquait encore davantage sa capacité à fournir un avis pertinent sur un texte qui n’est plus d’actualité.
- Inadéquation des Compétences : Se prononcer sur un texte qui avait déjà été adopté et qui n’attendait plus que la sanction et la promulgation par le gouvernement aurait étendu les compétences du Conseil d’État au-delà de ce que permettent les lois coordonnées sur le Conseil d’État. En effet, cela reviendrait à donner un avis indirect au gouvernement, ce qui est incompatible avec les rôles respectifs des différentes branches du pouvoir.
- Procédure Parlementaire : L’article 55, paragraphe 4 du Règlement du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait permis la poursuite de l’examen du texte sans attendre l’avis du Conseil d’État. Cette procédure a rendu impossible pour le Conseil d’État d’exercer son rôle de manière efficace, car le texte avait déjà été adopté et ne pouvait plus être soumis à une consultation préventive.
Que faut-il retenir de cette nouvelle réforme ? Quels seront les critères de réussite pour l’année 2024-2025 ?
Selon les dispositions de ce décret, les étudiants qui ont entamé leur cursus sous le régime « Marcourt« et qui étaient considérés comme finançables pourront bénéficier du même régime pour leur inscription dans le même programme l’année suivante, leur permettant de poursuivre leurs études sans interruption.
Par ailleurs, le décret modifie la règle des crédits à acquérir dans un laps de temps défini. Initialement fixée à 60 crédits à obtenir en deux ans maximum, cette exigence est assouplie, passant à 45 crédits pour l’année 2024-2025. La réforme offre ainsi aux étudiants une plus grande flexibilité dans la progression de leurs études et dans la gestion de leur charge de travail.
Enfin, le décret abandonne le critère de réussite d’un programme annuel (PAE) exigeant un minimum de 45 crédits. Cette suppression vise à réduire la pression sur les étudiants et à leur permettre de mieux adapter leur rythme d’études à leurs besoins individuels.
- Et quid de l’année en cours (2023-2024) ?
Pour les étudiants inscrits en 2021-2022 ou avant, une mesure de transition garantit qu’ils seront automatiquement considérés comme finançables pour leur cursus en 2024-2025, assurant ainsi la continuité du soutien financier.
Pour ceux inscrits en 2022-2023, des directives spécifiques sont établies en fonction de leur réorientation. Si un étudiant s’est réorienté, il devra réussir les 60 crédits de sa première année de bachelier (ou son PAE) d’ici la fin de l’année académique 2024-2025. En revanche, s’il ne s’est pas réorienté, il lui suffira de valider au moins 45 crédits de sa première année de bachelier d’ici août 2024.
Pour les étudiants de la promotion 2023-2024, l’exigence est claire : ils doivent réussir 60 crédits de leur première année de bachelier (PAE) avant la fin de l’année académique 2024-2025.
Une modification importante doit être soulignée. Désormais, si un étudiant réussit tous ses cours, il sera finançable l’année suivante, quel que soit le nombre de crédits de son PAE. De plus, en cas de réorientation après la deuxième année, l’étudiant aura deux ans pour achever sa première année de bachelier, avec un total de cinq années pour obtenir son diplôme de bachelier.
Une erreur dans cet article ? Faites-le nous savoir : contact@lessurligneurs.eu